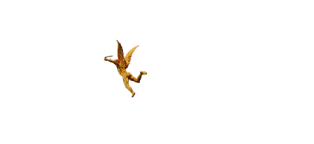L’engagement citoyen de la jeunesse : un potentiel en puissance à valoriser ? | Dans l’oeil de L’Ascenseur #4
« L’égalité des chances fait partie de mes aspirations et de mes valeurs. J’ai décidé de rejoindre la Génération Ascenseur pour rendre ce que toutes les structures de L’Ascenseur m’ont apporté. Mon engagement dépasse les obstacles que j’ai pu rencontrer. Donner de mon temps aux autres est un moyen de me sentir vivre.»
Extrait du Discours de Memet Kemaloglu, au Conseil économique social et environnemental le 5 novembre 2023 lors de l’évènement #GénérationEngagée organisé par L’Ascenseur et L’ Institut de l’Engagement.

Face aux différents bouleversements et crises – économique, sociale, écologique, géopolitique ou encore sanitaire – qui pèsent sur son avenir, la jeunesse d’aujourd’hui s’avère être en quête de sens. C’est un fait : depuis la pandémie et les confinements, 56 % des jeunes s’estiment être davantage en recherche de projets consistants et d’engagement dans le cadre de leurs études ou de leur vie professionnelle. Le témoignage de Mehmet Kemaloglu illustre parfaitement cette planche de salut et donne vie à ce constat dressé par Jérôme Fourquet pour la Fondation de France : 81 % des jeunes estiment que leur génération a le pouvoir d’agir.
Alors que les générations précédentes l’imaginent souvent individualiste, matérialiste ou paresseuse, la jeunesse d’aujourd’hui ne cesse de démontrer qu’elle porte des aspirations, des désirs et des valeurs. Elle agit, s’exprime, s’engage. Et bien souvent, hors des sentiers battus, des partis politiques et des bulletins de votes : par le service civique (fondé par Martin Hirsch en 2012 qui permet aux 16-30 ans de s’engager au service de l’intérêt général), à travers les réseaux sociaux, le militantisme ou encore le bénévolat. Et pour preuve : début 2022, la participation bénévole des jeunes au sein d’une association ou d’une autre organisation atteint son plus haut niveau depuis 2016.
Pour mieux comprendre ce qui se joue lorsque l’on parle de l’engagement citoyen de cette nouvelle génération, nous avons interrogé Quentin Jagorel, Directeur Général de l’Institut de l’Engagement (IDE). En quelques mots, cette association est source d’opportunités et de projets d’avenir pour des profils qui ont fait le choix de s’engager en faveur de l’intérêt général. Grâce à 2 000 bénévoles et 350 partenaires à ses côtés, l’Institut permet à des milliers de jeunes qui se sont engagés dans un volontariat (Service Civique, Corps Européen de Solidarité, Volontariat de solidarité international) ou un bénévolat, de valoriser leur engagement et de structurer un projet qui leur est cher.

L’IDE propose à 700 d’entre eux (les « lauréats de l’Institut »), repérés pour leur potentiel et la qualité de leur engagement, un accompagnement individualisé qui leur permet de franchir les barrières et les obstacles scolaires, culturels, sociaux, financiers, liés à un handicap. Cette association ouvre le champ des possibles et propose différents regards sur le monde qui nous entoure. Chaque jeune peut y trouver des clés pour porter ses valeurs d’engagement et de citoyenneté tout au long de son parcours scolaire, étudiant et professionnel.
Ces jeunes engagés, qui sont-ils ? Quentin Jagorel insiste bien sur la diversité des profils des bénéficiaires accompagnés aussi bien que sur la variété des projets portés par ces derniers :
“Nous avons une hétérogénéité des profils : 70% de femmes, dans l’ensemble des jeunes entre 17 et 29 ans. Certains sont uniquement titulaires d’un baccalauréat ; d’autres ont déjà un master 2. Sur la totalité de nos bénéficiaires, 50% sont boursiers, 10% proviennent de QPV, 10% de zones de revitalisation rurale. Nous proposons deux grands parcours : la filière formation, pour ceux qui souhaitent reprendre des études et qui passent à l’Institut afin d’intégrer Sciences Po Paris, des grandes écoles ou toute autre formation. Il faut bien préciser qu’il n’y a pas que les grandes écoles ! Puis, la filière où nous soutenons ceux qui ont à cœur de créer leur activité : une association, une entreprise, un festival. ”

Comment s’engagent-ils ? Là encore il est difficile de définir leur forme d’engagement sans en restreindre le sens et toutes ses possibilités.
Si les marches pour le climat, le mouvement #metoo et les manifestations Black Lives Matter sont des exemples récents où les jeunes ont pris une place prépondérante, l’engagement citoyen demeure protéiforme.
Selon Quentin Jagorel, “on peut parler d’engagement à partir du moment où il y a une notion de don : je donne pour la collectivité du temps, une partie substantielle de mon énergie, parfois de mon argent. Un tweet n’a pas le même impact, la même signification qu’une action. Nous ne pouvons pas adresser un jugement, bon ou mauvais de l’engagement. Pour les jurys de l’Institut, nous avons des critères basés sur des faits bien précis : tu as fait un service civique de 6 mois, c’est un engagement, tu es donc éligible. Tu as fait un bénévolat de 8 mois dans une asso même sportive, à raison de 14 heures par semaine, parce que tu es trésorière de l’association ? C’est un engagement.”
Quoiqu’il en soit, ce n’est plus à prouver : l’engagement citoyen de la jeunesse existe, et fait preuve d’une grande vitalité. Les associations orientées sur cette thématique – à l’image de Benenova, Alter’Actions, ou encore Passerelles et Compétences ne cessent d’en renforcer le pouls. Pourtant, contrairement aux idées reçues, “très peu de jeunes s’auto-identifient comme engagés. Il y a une sorte de réticence, de pudeur à s’auto-qualifier d’engagé” pour reprendre les propos du Directeur de L’Institut de l’Engagement.
Il apparaît alors nécessaire de conscientiser, de valoriser ces actions citoyennes, ces dons de soi en faveur du plus grand nombre. Primo, l’engagement est source d’apprentissage. Il permet, au même titre qu’une expérience professionnelle d’acquérir des compétences, notamment les soft skills, essentielles à la suite d’un parcours et bien souvent niées par le monde académique. Cet engagement permet de définir, préciser un projet ou une initiative sans oublier toute la dimension de socialisation et de construction d’un premier réseau.
Comme le rappelle très justement Quentin, “Il faut en faire quelque chose, il ne s’agit pas de fermer la parenthèse. Le service civique, c’est une expérience mais il faut pouvoir rebondir et ne pas retourner au chômage par exemple. C’est pour cela que la valorisation est cruciale.”
Si quelques initiatives émergent des pouvoirs publics, il faut absolument favoriser l’engagement de la jeunesse à travers des mesures concrètes. Évidemment, cela nécessite une enveloppe budgétaire solide et une vision stratégique pérenne. Bien souvent, les associations donnent le cap et proposent des recommandations : systématiser la délivrance d’attestations pour les bénévoles, développer des parcours citoyens dès le plus jeune âge, créer une délégation interparlementaire pour la jeunesse, ou encore redynamiser le service civique par une rémunération vue à la hausse.
Les résultats ne sont plus à prouver tel que le souligne Quentin Jagorel : “A l’Institut, on a de 92 à 94 % de nos jeunes qui, après un an d’accompagnement, soit ont validé une année de master, soit ont trouvé un emploi en CDD de moins de 6 mois, soit ont créé leur boîte.” Pour Quentin, l’une des clés pour favoriser l’engagement et inciter les jeunes, réside dans les effets de synergies :
“Je pense que l’engagement peut être contagieux et qu’il a d’autant plus d’impact quand il sort de sa bulle et cela passe par la création d’espaces sécurisants où des jeunes engagés peuvent s’exprimer. Je dirais que l’impact de l’engagement est démultiplié quand on fait se rencontrer différentes sphères et différents types d’engagements.”
A l’image du collectif de L’Ascenseur qui fédère les acteurs publics, privés et associatifs, il est urgent de créer un véritable écosystème. L’Institut de l’Engagement crée des rencontres entre les entreprises partenaires et leurs bénéficiaires afin de susciter le débat sur un sujet en particulier, confronter les points de vues, challenger les idées établies. L’objectif est de créer des passerelles entre les jeunes et les grands groupes, de leur donner la parole. Et cela ne peut se faire sans une volonté assumée des acteurs privés. En bref : les entreprises, elles aussi, doivent prendre leur part et s’engager.
L’engagement citoyen est multiple, singulier. Il représente donc une source d’opportunités inégalable pour la jeunesse ainsi qu’un véritable levier en faveur de l’égalité des chances. Il mérite donc d’être accompagné à juste titre. Il appartient au gouvernement de le valoriser et l’encourager, à travers, par exemple, la promotion du bénévolat, du mentorat, du volontariat. Impulser une société de l’engagement citoyen doit être un des chantiers prioritaires des politiques publiques et c’est ensemble, main dans la main avec le milieu associatif et la société civile que les objectifs seront atteints.

Revenir aux Tribunes